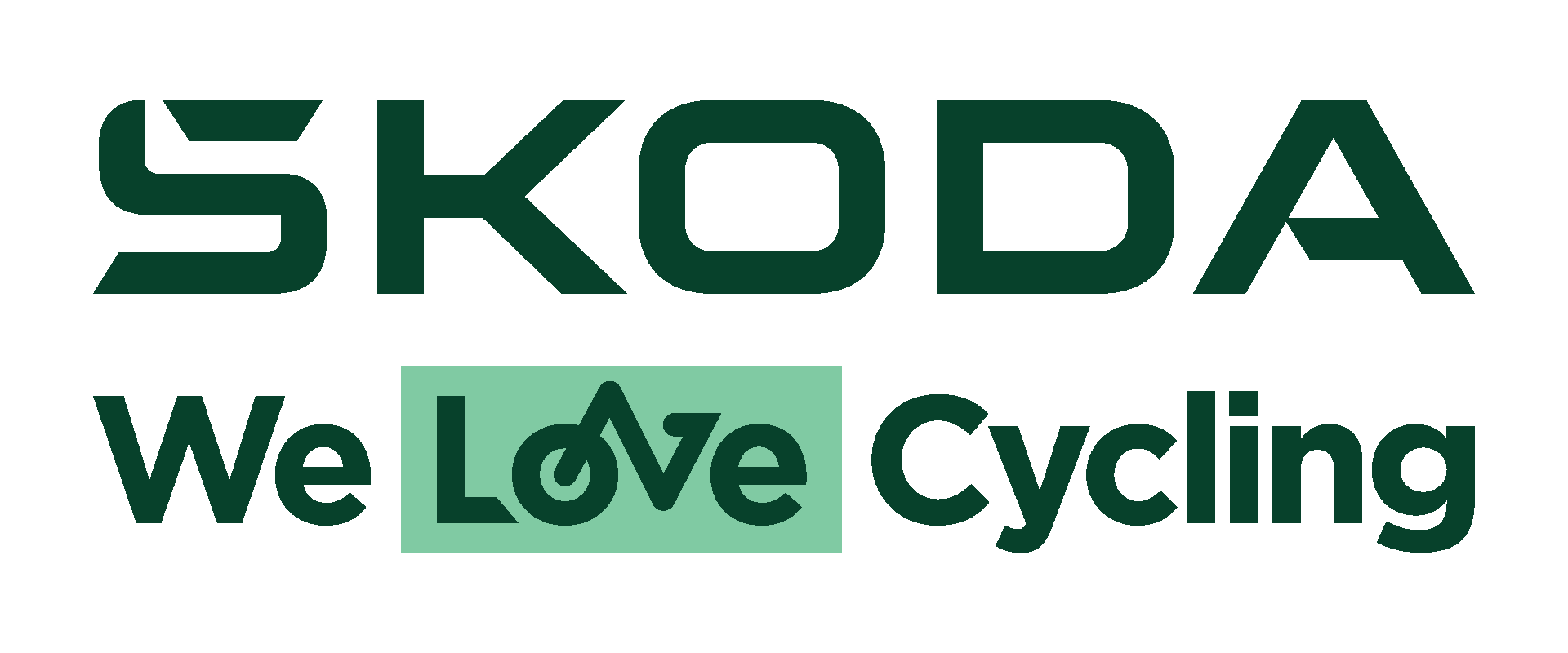Le cyclisme féminin a connu une transformation remarquable au cours de la dernière décennie. Cette évolution concerne notamment les structures salariales et la viabilité financière des équipes et des athlètes.
L’introduction des salaires minimums et son impact
Avant 2020, aucune grille salariale n’était imposée dans le peloton féminin. Ainsi, de nombreuses coureuses vivaient de primes, de sponsors personnels, ou exerçaient un second emploi. Cette précarité freinait la professionnalisation du sport.
Toutefois, l’instauration d’un salaire minimum obligatoire pour les équipes Women’s WorldTour a marqué un tournant décisif. Ce dispositif a permis d’aligner les conditions salariales des femmes sur celles des hommes évoluant en ProTeam.
En 2020, le salaire minimum était fixé à 15 000 € par an pour les indépendantes et 26 849 € pour les salariées. Depuis, ces montants n’ont cessé d’augmenter, si bien que les écarts se réduisent progressivement.

Détail des revenus : combien gagnent réellement les cyclistes ?
Le salaire minimum a permis de relever le niveau général, mais les écarts restent toujours marqués dans le peloton féminin.
Salaires minimums
Dans une équipe ProTeam (type Arkéa-B&B Hotels ou Cofidis), le salaire minimum obligatoire est de 20 000 € / an.
En Women’s World Tour, il varie selon le statut :
- Coureuse salariée : 38 000 € / an (ou 32 000 € / an pour une néo-pro).
- Coureuse sous contrat de prestation : 62 000 € / an (ou 52 000 € / an pour une néo-pro).
WorldTour moyen
En moyenne, une cycliste du Women’s WorldTour gagne entre 80 000 € et 100 000 € par an. Ce niveau reste encore bien en deçà du peloton masculin, mais représente une nette progression par rapport aux années précédentes.
Cyclistes du top 20 mondial
Celles qui se situent parmi les meilleures mondiales, sans être les stars les plus bankables, peuvent gagner entre 200 000 € et 500 000 € par an. On y retrouve des noms bien connus du peloton comme Kasia Niewiadoma, Pauline Ferrand-Prévot ou encore Lorena Wiebes, dont la régularité et les performances leur permettent d’obtenir des contrats parmi les plus valorisés du circuit.
Les stars du peloton
Au sommet, les grandes figures de la discipline rivalisent désormais avec les salaires masculins.
- Demi Vollering : plus de 900 000 € / an, avec des rumeurs proches du million.
- Lotte Kopecky : environ 900 000 € / an.
- Elisa Longo-Borghini : environ 800 000 € / an.
Comment ces salaires se comparent-ils à ceux du peloton masculin ?
Toutefois, les revenus féminins restent bien inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. À titre de comparaison, le salaire moyen d’un coureur WorldTour masculin s’élève à 501 000 € par an.
Les stars masculines, comme Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard, gagnent entre 6 et 7 millions d’euros par an. Même les équipiers masculins touchent souvent plus de 200 000 €, soit le double d’une équipière féminine.
Cette différence s’explique par la visibilité médiatique plus forte du cyclisme masculin. Elle attire plus de sponsors et augmente les budgets des équipes.

Le rôle du sponsoring et des primes de course
Comme dans d’autres disciplines, le sponsoring reste la principale source de financement des équipes. Contrairement aux sports basés sur la billetterie ou les droits TV, le cyclisme repose largement sur les partenariats de marque.
Heureusement, l’arrivée de grands sponsors dans le cyclisme féminin a contribué à l’amélioration des ressources. Toutefois, l’écart reste significatif. Les meilleures équipes féminines disposent de budgets annuels de 6 à 7 millions d’euros, contre plus de 40 millions d’euros pour les équipes masculines les plus puissantes.
Les disparités salariales ne s’arrêtent pas là. Elles se retrouvent également dans les primes de course. Par exemple, en 2022, le Tour de France Femmes avec Zwift proposait une cagnotte de 250 000 €, dont 50 000 € pour la gagnante. Un événement qui ne cesse de prendre de l’ampleur d’année en année, comme nous l’expliquons plus en détail dans cet article dédié.
Cela marque un progrès important. Toutefois, la comparaison avec le Tour de France masculin, dont la dotation dépasse 2,3 millions d’euros, montre bien l’ampleur du chemin qu’il reste à parcourir.
Et demain ? Le futur des salaires dans le cyclisme féminin
Malgré tout, l’évolution suit une trajectoire positive. Plusieurs leviers pourraient permettre de combler les écarts :
Croissance des sponsors
L’intérêt croissant des marques pour le cyclisme féminin pourrait permettre d’augmenter les budgets et les salaires.
Amélioration de la couverture médiatique
Plus de retransmissions TV ou en streaming pour les courses féminines pourraient élargir le public et stimuler les revenus.
Plafonnement des salaires et partage des revenus
Certains experts proposent d’instaurer des plafonds salariaux ou un modèle de redistribution pour créer un écosystème plus durable.
Vers la barre du million ?
Les discussions autour de salaires dépassant le million d’euros pour les meilleures coureuses sont déjà en cours. Certains noms pourraient franchir ce cap dans les années à venir.

Une route prometteuse, mais encore inégale
En somme, le cyclisme féminin a franchi un cap important grâce à l’introduction des salaires minimums et à une professionnalisation accrue. Les conditions de travail sont bien meilleures qu’il y a dix ans.
Toutefois, les écarts avec le cyclisme masculin restent notables, en particulier au sommet. Car combler ces écarts nécessite une stratégie globale mêlant investissements, visibilité et équité.
Ainsi, la parité salariale dans le cyclisme ne relève plus du simple idéal. Elle devient un objectif réaliste, à condition de poursuivre sur cette lancée. La route est encore longue, si bien que chaque avancée compte plus que jamais.